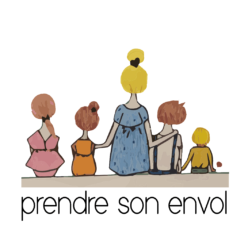Des violences verbales qui deviennent des violences physiques : c’est la spirale décrite par Clémence qui a mis du temps à porter plainte contre son agresseur par peur des conséquences. Des manifestations sont prévues dans plusieurs grandes villes de France, ce 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes, pour dénoncer ce fléau et demander une meilleure protection des victimes.
Clémence a 34 ans, elle est mère de quatre enfants. Pendant un an, elle a été battue par son conjoint. Ce dernier n’a pas accepté que Clémence veuille se séparer de lui. La jeune femme qui travaille en Ardèche explique la spirale de la violence. Tout commence par une agressivité verbale : « Il me parlait comme jamais, il ne m’avait parlé, et j’avais l’impression, en fait, de voir en face de moi un inconnu, alors qu’on avait partagé 14 ans de vie commune ». Une violence que la jeune femme commence par nier : « J’ai laissé passer les premiers coups en me disant que c’était presque de ma faute parce que je le rendais fou et qu’il était malheureux, et que du coup ça dérapait, mais que ce n’était pas très grave ».
Les enfants de Clémence ont malheureusement assisté à ces scènes. Et c’est ce qui, pour elle, a été l’élément déclencheur. « C’est la première fois que j’ai porté plainte, parce qu’il m’a frappé devant les enfants, en me laissant vraiment au sol, en sang, devant eux. Suite à l’altercation devant les enfants, j’ai compris et je me suis dit que s’il n’arrêtait pas de taper, il allait me tuer devant eux ».
La peur, un obstacle omniprésent
Un dépôt de plainte qui pourtant n’est que le début d’un long parcours. Devant les instances policières puis judiciaires, en passant par les consultations médico-légales, les travailleurs sociaux de l’aide sociale à l’enfance aussi. Un chemin de croix qui se heurte aux manques de moyens des pouvoirs publics. Mais parfois aussi aux errements psychologiques des victimes qui parfois reviennent sur leurs accusations, comme l’explique, Blandine Weck de Terris avocate.
« Une femme victime qui me dit : ‘Je veux retirer ma plainte’, souvent quand je lui demande : ‘Ah bon, pourquoi ?’, elles me disent rarement : ‘parce que j’ai menti’. Elles vont plutôt me dire : ‘Parce que je ne veux pas qu’il ait de problème’, et ce n’est pas du tout la même chose. Très souvent, elles maintiennent ce qu’elles ont pu dire dans leur plainte. En fait, elles ont peur de porter la responsabilité des conséquences futures que peuvent avoir leur déclaration, et moi, mon travail, en tant qu’avocate de victimes de violences conjugales, c’est de leur dire : ‘Le fautif, c’est lui. S’il est sanctionné, ce n’est pas à cause de vous qui avait déposé plainte, c’est éventuellement à cause du tribunal, parce que c’est lui qui condamne, mais c’est surtout à cause de lui’. De toute façon, une personne qui retire sa plainte, que ce soit pour des violences conjugales ou pour n’importe quelle infraction, n’importe quel fait, ça n’empêche absolument pas le procureur de décider de poursuites malgré tout, parce que ce n’est pas la victime qui décide s’il doit y avoir un procès, s’il doit y avoir un jugement, une condamnation, c’est le procureur, ou la procureure, qui demande au tribunal de condamner telle personne et après, le tribunal condamne, ou ne condamne pas, selon les éléments de preuve qu’il y a dans le dossier ».
Une protection des victimes difficiles à mettre en œuvre faute de moyens
NewsletterRecevez toute l’actualité internationale directement dans votre boite mail
Pour prévenir ces violences conjugales, pour sanctionner leurs auteurs, un important arsenal législatif a été mis en place au fur et à mesure des années. L’accent a notamment été mis sur la prévention des récidives et la protection des victimes qui devront désormais obligatoirement être averties lors de la sortie de prison du conjoint. C’est ce que prévoit un décret, entré en vigueur le 1 février 2022. Le texte précise que l’autorité judiciaire devra alors « expressément » s’interroger sur la nécessité de mettre en place des mesures de protection pour ces victimes.
Une application rendue quasi impossible par l’absence de moyens ad hoc débloqués et la surcharge de travail qui incombe déjà aux magistrats, regrette Albertine Munoz, juge d’application des peines au tribunal de Bobigny : « Les moyens qu’on a actuellement ne nous permettent pas de faire ce signalement dans des délais qu’on estime satisfaisants. Demander l’avis à la victime, c’est aussi savoir si elle veut bénéficier d’un dispositif de protection, comme le bracelet anti-rapprochement. Et cela demande une organisation en amont. On doit solliciter les associations d’aide aux victimes, le greffe des établissements pénitentiaires. Pour peu que la victime n’habite pas dans le département dans lequel la personne condamnée vit ou est incarcérée, il faut qu’on repasse par d’autres intermédiaires. Si la personne condamnée a commis les faits il y a très longtemps, il faut qu’on arrive même à localiser la victime, vous voyez, on en est à ce stade-là ! ».
Des investigations lourdes, difficiles à réaliser, constate la juge interrogée sur RFI puisque les nouvelles réformes ont été réalisées à effectifs constants, sans aucun moyen supplémentaire. La plupart des services d’application des peines ne sont pas en état de les mettre en place. Il n’y a aucun mécanisme, par exemple, de centralisation des associations d’aide aux victimes. « Je peux prendre contact avec une association qui va me répondre qu’elle n’est pas compétente pour tel territoire, ou pour tel dispositif de protection, poursuit la juge. Vous voyez, on perd énormément de temps, alors que moi, j’ai toujours mes mille dossiers à gérer. Avec ma greffière, on est censées aller à cette pêche aux informations dans des dossiers très sensibles ».