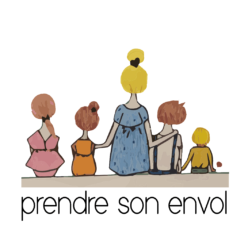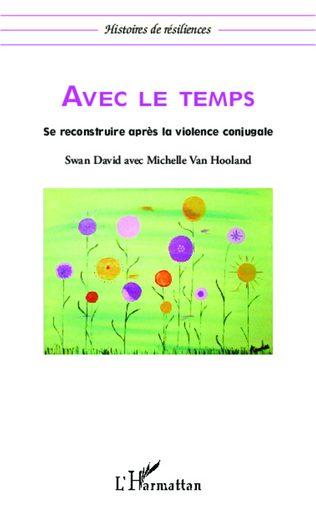Mots-clés : violences conjugales • harcèlement • suicide forcé • violation du secret médical • atteinte à l’intimité de la vie privée • mandat criminel • peines alternatives à l’emprisonnement.
La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, visant à protéger les victimes de violences conjugales (N° Lexbase : L7970LXH), comporte de nombreuses dispositions pénales. Les dispositions applicables aux infractions commises dans la sphère conjugale proposent des nouveautés – notamment l’incrimination du suicide forcé ou la levée du secret médical – finalement assez limitées dans leurs effets. Il en va en revanche différemment de certaines dispositions qui dépassent le cadre du couple – telle que la répression de la géolocalisation non consentie ou encore la conversion de peines alternatives en peines complémentaires à l’emprisonnement.20
173 personnes – 145 femmes et 27 hommes – ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon en 2019. 24 décès supplémentaires en 2018, soit une augmentation de 21 % en un an [1]. Cette « hausse effroyable » [2] fait froid dans le dos. La France se classe d’ailleurs parmi les États dans lesquels ce type de violences, au sein du couple, reste important [3]. Il est malheureusement à craindre que les chiffres ne baissent pas cette année, puisqu’on sait déjà que les violences conjugales ont augmenté pendant le confinement [4]. On comprend donc bien que la lutte contre les violences conjugales ait fait déjà l’objet de nombreuses lois [5], et soit revenue au cœur des débats au cours de l’année 2019, prenant une ampleur inédite au sein l’opinion publique.
Plus précisément, le Gouvernement a fait de la lutte contre les violences conjugales une « grande cause du quinquennat » et a organisé, de septembre à novembre 2019, le Grenelle des violences conjugales. Il a immédiatement reçu de très – trop ? – nombreuses tentatives de traductions juridiques : on pense à la volonté d’insérer le terme « féminicide » dans notre Code pénal, qui n’a finalement pas été retenue [6], à la circulaire de la garde des Sceaux adressée au parquet le 9 mai 2019 [7], au Livre Blanc déposé à l’Assemblée Nationale le 6 novembre 2019 [8], puis au dépôt de projets ou propositions de lois concurrents sur le sujet [9]. De cette multitude de volontés désordonnées, trahissant l’empressement à traiter un sujet au cœur du débat public et médiatique, est né un arsenal législatif composé de deux lois.
La première est la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille adoptée le 28 décembre 2019 [10]. Au plan civil, elle a renforcé l’ordonnance de protection et restreint la médiation familiale en cas de violences commises au sein de la famille. Au plan pénal, elle entendait notamment rendre effectif le bracelet anti-rapprochement et généraliser l’utilisation du Téléphone Grave Danger. On peine à savoir pour l’instant quelle sera l’efficacité des mesures adoptées. Un décret d’application de la loi du 27 mai 2020 [11] a déclenché la colère des praticiens [12], à tel point qu’il a fallu revoir les modalités de saisine du juge aux affaires familiales un mois plus tard [13], et le bracelet anti-rapprochement n’est toujours pas opérationnel [14].
La seconde loi est celle du 30 juillet 2020, objet de notre étude. On peut déjà s’interroger sur la pertinence d’une législation dispersée, élaborée en deux temps, alors qu’un texte unique, concentrant l’ensemble des dispositions, aurait sans doute été plus adapté. Mais ce second texte visait à reprendre certaines réflexions menées pendant le Grenelle des violences conjugales, qui n’avaient pas été traduites par la première loi [15].
Sur la forme, la procédure législative accélérée a été mise en œuvre. Mais les contraintes liées à l’épidémie de covid-19 ayant momentanément empêché l’adoption du texte, c’est finalement au cœur de l’été, juste avant les vacances parlementaires, que la loi a été votée.
Sur le fond, y avait-il encore à faire ? Y avait-il des mesures oubliées ? On serait tenté de croire que non à la lecture des deux premiers articles de la proposition de loi. Ils prévoyaient en effet le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pour violences au sein de la famille, et ont finalement été supprimés, car une disposition similaire avait déjà été adoptée dans la loi du 28 décembre 2019. Mais la première impression est trompeuse, tant la loi du 30 juillet est riche, sur le plan civil, et plus encore sur le plan pénal qui nous occupera ici [16].
En matière civile, on se contentera de rappeler que la loi prévoit l’attribution de la jouissance du logement conjugal au conjoint qui n’est pas l’auteur de violence [17], et renforce l’interdiction de paraître dans le cadre de l’ordonnance de protection [18]. Elle décharge aussi le débiteur du versement de l’obligation alimentaire à l’égard de l’auteur des violences, qu’elles aient été commises contre le débiteur ou contre l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs [19]. Elle retient enfin une nouvelle hypothèse d’indignité successorale facultative afin que celui qui est condamné, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt, puisse être exclu de la succession [20].
Les dispositions pénales viennent ensuite, et leur importance surprend. Le titre de la loi la dédie toute entière à « la protection des victimes de violences conjugales ». Or, à la lecture du texte, le périmètre défini par le titre n’est pas respecté. Les violences ne sont pas les seules infractions concernées, et de surcroît, le cadre de la vie conjugale est largement dépassé. L’article 132-80 du Code pénal (N° Lexbase : L6235LLI) retient certes une vision large de la sphère conjugale, visant le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ou lorsque la relation a pris fin. Mais la loi du 30 juillet va plus loin. Si certaines de ses dispositions concernent exclusivement le couple, d’autres ont une vocation beaucoup plus large. Plus encore, les dispositions spécifiques aux violences conjugales paraissent restreintes, y compris la mesure phare de la loi, qui permet la levée du secret médical (I). A l’inverse, les dispositions qui dépassent le cadre du couple ont une toute autre ampleur (II).
I. Des dispositions spéciales limitées
Par souci de protection des victimes d’infractions commises au sein du couple, la loi accroit la répression en multipliant les circonstances aggravantes (A), et entend aussi faciliter sa mise en œuvre, en levant des obstacles aux poursuites (B).
A. Le renforcement des circonstances aggravantes
Depuis 2010, de plus en plus d’infractions contre les personnes, issues du livre II du Code pénal, sont plus sévèrement punies lorsqu’elles sont commises au sein du couple. La peine encourue est précisément augmentée lorsque les faits sont commis par « le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » [21]. La loi du 30 juillet s’inscrit dans cette même dynamique, en prévoyant que la même circonstance aggravante s’appliquera aux appels téléphoniques malveillants [22], à l’usurpation d’identité [23] et à l’atteinte au secret des correspondances [24]. Le législateur marque sa particulière réprobation à l’égard des « cyberviolences », ou du « cybercontrôle », au sein du couple. Ces expressions désignent l’utilisation de (nouvelles) technologies pour surveiller son partenaire. Mais c’est une autre circonstance aggravante qui retient l’attention.
La loi prévoit en effet la création d’une nouvelle circonstance aggravante pour punir ce qu’on a appelé le « suicide forcé » [25]. Plus précisément, est aggravé le harcèlement prévu par l’article 222-33-2-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8545LXR), défini comme « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » [26]. Selon le dernier alinéa du texte, ajouté par la loi du 30 juillet, « les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider ». On comprend la volonté de punir plus sévèrement un harcèlement si grave qu’il aurait pour conséquence de pousser la victime à mettre fin à ses jours. D’ailleurs, certaines études avancent que 13 % des suicides seraient en lien direct avec des violences conjugales [27]. Cependant, cette disposition appelle deux séries de remarques.
D’abord, cette circonstance aggravante présente une originalité en ce qu’elle tient au résultat du comportement de l’auteur. Elle ne tient pas aux circonstances entourant la commission des faits, à l’auteur ou à la victime, mais aux conséquences du harcèlement. Classiquement, le résultat est davantage intégré aux éléments constitutifs de l’infraction, de façon à dicter la qualification des faits. Il permet par exemple de distinguer infraction formelle et matérielle. La loi du 30 juillet 2020 propose une solution différente en tenant compte du résultat du comportement à titre de circonstance aggravante.
Ensuite, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur le recoupement de cette circonstance aggravante avec d’autres qualifications, permettant déjà de saisir de tels faits [28]. Ce sont plus précisément la provocation au suicide et les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner qui pourraient trouver à s’appliquer.
La distinction entre le nouveau suicide forcé et la provocation au suicide se perçoit assez facilement. Les éléments matériels peuvent se recouper, mais les éléments moraux des deux infractions diffèrent. La provocation au suicide n’est en effet constituée que si l’auteur avait la volonté de pousser la victime à se suicider [29]. À l’inverse, dans le harcèlement aggravé, l’auteur des faits n’a pas l’intention de pousser la victime à mettre fin à ses jours.
La distinction entre suicide forcé et violences mortelles est bien plus délicate. L’élément matériel est identique, puisque les violences peuvent être uniquement morales [30], avoir causé un « choc émotif » à la victime [31]. L’élément moral ne diffère pas non plus, puisque dans les deux cas, l’auteur ne doit pas avoir eu la volonté de parvenir au résultat. Dès lors, il est tout à fait envisageable que le harcèlement qui a conduit le conjoint à mettre fin à ses jours soit constitutif de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner [32]. À la lecture des travaux parlementaires, c’est la difficulté de prouver le lien de causalité entre les actes de violence et la mort de la victime qui a conduit à écarter les violences mortelles [33]. Il faudrait en effet montrer que les violences morales sont bien la cause du décès de la victime, et que ce lien de causalité n’a pas été rompu par l’acte de suicide de la victime elle-même. Cependant, toute causalité n’est pas absente dans le harcèlement aggravé que le législateur a retenu. Il faudra ici prouver de la même façon la causalité entre les comportements harcelants et le suicide [34]. Ce n’est pas parce que l’on opte pour une circonstance aggravante que la nécessité de prouver le lien de causalité disparaît. Le champ d’application de cette nouvelle incrimination pourrait donc bien être très restreint. En outre, on notera que la peine encourue est moindre pour le suicide forcé, 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, que pour les violences mortelles commises au sein du couple, lesquelles sont un crime puni de 20 ans de réclusion criminelle.
La création de cette nouvelle circonstance aggravante ne s’imposait donc pas. Le rapport du Sénat invoque d’ailleurs au soutien de cette disposition la fonction « expressive » ou « socio-pédagogique » du droit pénal [35], montrant combien son impact pourrait être limité. Il en va de même de certains obstacles aux poursuites qui ont été levés.
B. La levée des obstacles aux poursuites
Le législateur a cherché à faciliter les poursuites en matière de violence conjugales.
Il s’attaque d’abord à l’obstacle probatoire. Est ainsi prévu que l’officier de police judiciaire informe la victime de violences conjugales de son droit de se voir communiquer le certificat de l’examen médical requis pas le procureur ou l’officier de police judiciaire [36]. Il s’agit ici de faciliter la preuve des violences subies. La disposition est heureuse, tant on sait que les difficultés probatoires sont grandes en cas de violences conjugales.
De la même façon, le législateur entend lever les obstacles aux poursuites lorsque des délits, on va au-delà des violences ici, sont commis au sein du couple. Il admet donc une nouvelle exception aux immunités familiales. Les immunités familiales, applicables à de nombreuses infractions d’atteintes aux biens [37], impliquent que les faits ne soient pas poursuivis lorsqu’ils ont été commis au préjudice d’un ascendant, d’un descendant, ou d’un conjoint [38]. L’objectif est de préserver l’honneur, la paix des familles et d’éviter les difficultés probatoires pour attribuer un droit de propriété au sein de la famille. Mais ces immunités familiales – dont on peine d’ailleurs à identifier la nature : fait justificatif ou obstacle aux poursuites ? – sont de moins en moins bien comprises, et de plus en plus limitées [39]. Au sein du couple plus particulièrement, le législateur a exclu du champ de ces immunités les infractions portant sur « les objets ou les documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiements » [40]. La loi du 30 juillet ajoute à cette liste les moyens de « télécommunication ». On songe immédiatement à la soustraction du téléphone portable de la victime par le conjoint, qui pourra désormais être poursuivie et sanctionnée.
Par ailleurs, la loi du 30 juillet interdit le recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales. L’alternative aux poursuites, bien mal adaptée en cas de violences conjugales, se ferme définitivement. Auparavant, le recours à la médiation pénale était déjà strictement limité en cas de violences conjugales, au cas où la victime en faisait la demande expresse [41]. La référence à la volonté de la victime, souvent terrifiée par son conjoint, ne semblait cependant pas pertinente. La notion « d’emprise », mise en avant dans les réflexions du Grenelle, a achevé de convaincre les parlementaires de ne pas se référer à la volonté de la victime en cas de violences au sein du couple. L’interdiction pure et simple de la médiation pénale permet aussi de mettre en conformité notre droit avec la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique [42]. Il n’y a donc pas eu de véritable opposition, ni de débat, dans les discussions parlementaires. Le seul regret que l’on peut avoir est que cette mesure n’ait pas été adoptée dès la première loi de décembre 2019, laquelle avait déjà interdit le recours à la médiation familiale dans une telle hypothèse. Une circulaire l’avait d’ailleurs anticipé [43], et la loi du 30 juillet ne fait qu’entériner la pratique.
Mais la mesure phare de la loi, du moins celle qui a été le plus relayée dans les médias, est celle qui prévoit à l’article 226-14 du Code pénal (N° Lexbase : L8549LXW), la levée du secret médical en cas de violences conjugales. La levée du secret médical est présentée comme un moyen de rompre le silence qui entoure trop souvent les violences commises au sein du couple. Permettre aux professionnels de signaler ces violences serait un moyen de mieux les combattre.
Pourtant, le secret médical fait partie intégrante du serment d’Hippocrate [44] et est essentiel en ce qu’il instaure une relation de confiance entre le médecin et le patient, indispensable à l’efficacité des soins prodigués. L’intérêt de celui qui se confie est en cause, et l’intérêt général l’est également. « Ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion que le silence leur soit imposé sans condition ni réserve car personne n’oserait plus s’adresser à eux si l’on pouvait craindre la divulgation du secret confié » [45]. Dès lors, la violation du secret médical est réprimée par l’article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG). La Cour de cassation a même affirmé que « l’obligation du secret professionnel s’impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir » [46]. Pourtant, le terme « absolu » n’est pas exact. Le secret médical connaît des limites qu’il ne faut pas négliger. Depuis longtemps, il est des cas dans lesquels le médecin a l’obligation de révéler certaines informations couvertes par le secret [47], et d’autres cas dans lesquels on l’autorise à le faire [48]. Cependant, dans les deux hypothèses, la loi pénale, marquée par une redoutable complexité [49], semble faire le choix de ne pas condamner le médecin, ni s’il se tait, ni s’il garde le silence ; c’est ce que l’on nomme « l’option de conscience » [50]. « Les professionnels peuvent choisir de se taire ou de parler, le législateur s’en remettant à leur seule conscience » [51].
La modification de l’article 226-14 du Code pénal s’inscrit dans cette même logique : la loi du 30 juillet autorise, et n’oblige pas, le professionnel de santé – on va au-delà du médecin à strictement parler [52] – à lever le secret professionnel en cas de violences conjugales. Il faut en outre qu’un ensemble de conditions cumulatives, assez exigeantes, soit réuni. D’abord, les violences doivent être commises au sein du couple, et tomber sous le coup de la circonstance aggravante prévue par l’article 132-80 du Code pénal (N° Lexbase : L6235LLI). Ensuite, les violences doivent mettre la vie de la victime en danger immédiat. Un danger passé, futur, ou à plus forte raison hypothétique, ne peut suffire à autoriser la levée du secret. Le Conseil national de l’Ordre des médecins s’est prononcé en ce sens lors de sa session plénière du 13 décembre 2019, réservant la levée du secret médical aux cas d’urgence vitale immédiate [53]. Par ailleurs, la victime ne doit pas être en mesure de se protéger en raison d’une contrainte morale. Cette condition est plus complexe à appréhender. La notion de « contrainte morale », présente en matière d’infractions sexuelles, soulève des questions. On la définit traditionnellement comme une pression morale ou psychologique exercée sur la victime, mais le Code pénal ne donne des éléments de précision que lorsqu’un mineur est concerné [54]. Il faut de surcroît que « la contrainte morale résulte de l’emprise exercée par l’auteur des violences ». Or la notion d’emprise est une seconde notion floue, qui n’est cette fois pas du tout définie par le Code pénal. Enfin, le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime, et ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord (ce qui pourrait devoir être prouvé) qu’il peut prévenir le procureur, et à condition d’en avertir la victime.
A priori, toutes ces conditions évitent une atteinte trop importante au secret médical, et le point d’équilibre recherché serait ainsi trouvé. Cependant, cette disposition suscite deux types de critiques.
D’une part, cette disposition était-elle nécessaire ? Le médecin ne pouvait-il pas déjà lever le secret médical dans cette situation ? En effet, l’article 122-4 du Code pénal (N° Lexbase : L7158ALP) prévoit que n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte autorisé ou prescrit par la loi. Or l’article 223-6 du Code pénal (N° Lexbase : L6224LL4) sanctionne l’omission de porter secours et celle d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle. Autrement dit, cet article impose de porter secours à autrui, et excuse la violation du secret professionnel qui serait commise pour y parvenir [55]. Ce fait justificatif tiré de l’ordre de la loi peut fort bien s’appliquer en cas de violences conjugales. L’omission de porter secours punit précisément celui qui s’abstient d’aider une personne face à un péril grave, imminent et certain, ce qui correspond en tout point aux violences conjugales évoquées par le nouvel alinéa de l’article 226-14 du Code pénal. Dans cette hypothèse, « si le seul moyen efficace de protection consiste à transgresser le secret professionnel, l’obligation de porter secours prime » [56]. La modification apportée à l’article 226-14 du Code pénal relève donc davantage du symbole, et de la volonté de rassurer les professionnels de santé qui hésiteraient à dénoncer de tels faits, que de la nouveauté. Mais en ce cas, pourquoi ne pas mieux communiquer sur le droit existant, plutôt que d’ajouter une disposition sans réelle portée dans une matière déjà très complexe ?
D’autant qu’il ne faudrait pas que cette disposition ait un effet contre-productif [57]. Davantage conscientes du risque de signalement des violences dont elles sont l’objet, les victimes pourraient hésiter à se confier à leur médecin, voire à se soigner. De surcroît, la loi place sur un même plan les mineurs, les majeurs incapables et les victimes de violences conjugales, ce qui peut entraîner quelques réserves [58]. Enfin, en pratique, si la victime a refusé de donner son accord, la procédure risque de ne pas aller bien loin, mais d’avoir pour effet pervers d’alerter le conjoint.
On peut être déçu de ces dispositions, visant les faits commis au sein du couple, qui, sous couvert de nouveauté, ne modifient que très peu le droit existant. Il en va différemment des dispositions qui dépassent largement le cadre de la sphère conjugale, et qui modifient davantage notre droit pénal.
II. Des innovations de portée générale
Parmi les nombreuses dispositions de la loi ayant une portée plus générale, on retrouve une sévérité accrue en droit pénal de fond (A), et l’assouplissement de contraintes procédurales (B).
A. En droit pénal de fond
La loi prévoit la création de nouvelles incriminations aux articles 222-6-4 (N° Lexbase : L8541LXM), 222-26-1 (N° Lexbase : L8543LXP) et 222-30-2 (N° Lexbase : L8544LXQ) du Code pénal, construites sur le modèle du « mandat criminel ». L’article 222-26-1 dispose ainsi que « le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ». La même incrimination est reproduite pour les tortures et actes de barbarie et les agressions sexuelles. Le mandat criminel permet d’éviter l’impunité de celui qui commandite l’accomplissement d’un crime ou d’un délit, sans que le mandataire passe à l’action. Dans de telles hypothèses en effet ni la tentative (faute de commencement d’exécution), ni la complicité (faute de fait principal punissable) ne peuvent être retenue. On entend ici saisir l’auteur intellectuel des faits. Il ne faut toutefois pas oublier que l’on remonte considérablement sur l’iter criminis. Le mandat criminel était jusqu’à présent réservé à l’assassinat et à l’empoisonnement [59], des crimes particulièrement graves, portant atteinte à la vie. On conçoit son extension au viol et plus encore aux tortures et actes de barbarie, qui sont des infractions présentant un degré de gravité élevé. En revanche, étendre le mandat criminel à un délit, l’agression sexuelle, dont le degré de gravité est moindre au regard de la classification tripartie des infractions – et pourquoi seulement ce délit-là ? – est plus discutable. Il est d’ailleurs probable que ces textes trouvent peu d’occasions de s’appliquer.
Sans créer une nouvelle incrimination, le législateur a par ailleurs souhaité étendre le champ d’application d’une infraction déjà existante : l’atteinte à l’intimité de la vie privée. L’atteinte à l’intimité de la vie privée est désormais constituée lorsque a été captée, enregistrée ou transmise, « par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci » [60]. Il s’agit de combattre l’espionnage, la surveillance, qui peut être mise en place par l’un des membres du couple au préjudice de l’autre. Mais l’infraction peut s’appliquer au-delà – imaginons par exemple un employeur souhaitant géolocaliser son employé. Cette disposition, qui permet de lutter contre de nouvelles formes d’atteinte à la vie privée, ne devrait pas rester lettre morte.
La loi du 30 juillet étend aussi le champ d’une infraction protégeant les mineurs : le fait de mettre à leur disposition des messages à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger [61]. Le texte précise dorénavant que le simple fait que le mineur ayant consulté le message ait certifié avoir plus de 18 ans sera insuffisant pour faire échec à la répression. Il renforce également les pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel pour faire cesser l’infraction [62].
La seule disposition qui s’intéresse au sort de l’auteur des faits est relative aux peines qui peuvent être prononcées à son égard. Là encore, la loi du 30 juillet va bien au-delà de ce qu’on pouvait attendre, en modifiant sensiblement l’articulation entre peines complémentaires et peines alternatives à l’emprisonnement. Désormais, l’article 131-6 du Code pénal (N° Lexbase : L8530LX9) in fine prévoit que certaines peines alternatives – interdictions de détenir une arme, de paraître en certains lieux, de fréquenter certains condamnés et d’entrer en relation avec certaines personnes ; confiscation des armes ou de l’objet ayant permis la commission de l’infraction [63] – pourront dorénavant être prononcées en même temps que la peine d’emprisonnement. Autrement dit, ces peines alternatives deviennent des peines complémentaires. Et tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement, soit l’immense majorité des délits, sont concernés. Un autre choix, déjà préféré par ailleurs [64], aurait pu être fait : celui de réserver ce cumul à certaines infractions, ici celles à même de lutter contre les violences conjugales [65]. Mais cette disposition générale rompt la logique énoncée par l’article 131-9 du Code pénal (N° Lexbase : L8531LXA), qui voulait que les peines restrictives de droit ne soient pas prononcées cumulativement avec l’emprisonnement [67]. La disposition peut surprendre et le raisonnement qui la soutient encore davantage. En effet, les travaux préparatoires de la loi montrent que le législateur souhaitait que ces peines trouvent à s’appliquer dans le cas où la peine d’emprisonnement ne serait finalement pas exécutée [67]. Ce n’est donc pas un cumul de peines qui est recherché, mais bien qu’une peine vienne remplacer celle qui ne serait pas exécutée. Par conséquent, le recours à une peine complémentaire semble inadapté. Qui plus est, il ne faudrait pas contrarier le mouvement engagé vers une diminution des très courtes peines d’emprisonnement, leur effet néfaste ayant largement été dénoncé.
Plus classiquement, la loi augmente le quantum des peines encourues pour consultation de sites pédopornographiques : cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros sont désormais prévus, contre deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros auparavant [68]. Le changement n’est pas neutre. Il marque une plus forte réprobation à l’égard des faits commis, mais il permet aussi l’inscription de l’auteur des faits au sein d’un fichier judiciaire, ce qui relève de facilitations procédurales.
B. En procédure pénale
On retrouve dans la loi du 30 juillet une illustration du mouvement d’expansion du fichage en droit pénal. C’est bien pour permettre l’inscription au sein du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes, dit FIJAIS, que la peine encourue pour consultation de sites pédopornographiques a été rehaussée. En effet, l’article 706-53-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9749HES) impose un seuil de cinq ans d’emprisonnement pour que l’inscription au sein de ce fichier soit automatique, sauf décision spécialement motivée du procureur. Les personnes condamnées pour avoir consulté des sites pédopornographiques seront désormais enregistrées dans le fichier. La loi modifie par ailleurs l’article 706-53-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8555LX7), pour que l’inscription au sein du fichier soit de droit en cas de mise en examen du suspect, sauf décision du juge d’instruction. On accroit donc le champ du FIJAIS à la fois ratione materiae et ratione personae. Comme souvent, les facilités répressives permises par les fichiers l’emportent, même si leur encadrement n’est pas toujours extrêmement rigoureux ni cohérent [69].
Dans le même ordre d’idée, la loi assouplit l’article 56 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8552LXZ) qui prévoit les conditions dans lesquelles des armes peuvent être saisies lors d’une perquisition dans le cadre d’une enquête de flagrance. Le texte prévoit dorénavant que lorsque l’enquête porte sur des faits de violences, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. L’officier de police judiciaire peut ainsi se passer de l’autorisation du procureur, et saisir les armes indépendamment du lieu dans lequel elles se trouvent. L’innovation est moindre sur ce point, puisque l’article 56 autorisait déjà les officiers de police judicaire à procéder à une perquisition aux fins de saisie de biens « dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ». Or cet article vise entre autres « les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement », ce qui inclut les armes.
Enfin, la loi du 30 juillet a modifié l’article 113-5 du Code pénal (N° Lexbase : L8529LX8) donnant compétence à la loi pénale française pour réprimer la complicité par fourniture d’instructions [70], d’un crime commis à l’étranger. Elle supprime précisément les exigences procédurales entourant la mise en œuvre de cette compétence. Si les faits de complicité ont été commis en France, il ne sera plus nécessaire de respecter le principe de double incrimination, ni de vérifier qu’une décision définitive a été rendue par la juridiction étrangère. La seule condition tient désormais à l’infraction commise, qui doit être un crime relevant du livre II du Code pénal.
L’empressement ayant présidé à son adoption, la loi visant à protéger les victimes de violences conjugales n’a pas été suffisamment réfléchie. Parmi les dispositions circonscrites à la sphère conjugale, nombreuses sont celles qui risquent d’avoir bien peu d’effet. Il est assez significatif que le rapport du Sénat constate un « certain épuisement de la créativité du législateur dans le domaine de la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales » [71]. De fait, les nouveautés les plus importantes ont une portée générale. On peut tout de même regretter que le sort de l’auteur de violences, déjà ignoré du Grenelle [72], soit de nouveau peu abordé par la loi.
[1] Chiffres tirés de l’étude nationale relative aux morts violentes au sein du couple, rendue publique le 17 août 2020.
Sur la façon dont sont comptés les féminicides, v. Y. Bouchez et J. Bienvenu, Comment compter les féminicides ? Policiers, militants et journalistes appliquent leur propres règles, Le Monde, 16 janvier 2020 [en ligne].
[2] A.-C. Mailfert, Présidente de la Fondation des femmes, citée dans Le nombre de féminicides en augmentation en 2019, selon les chiffres du ministère de l’intérieur, Le Monde, 17 août 2020.
[3] V. not. l’étude de l’Agence européenne des droits fondamentaux, Violences à l’égard des femmes : une enquête à l’échelle de l’UE, 5 mars 2014, spéc. p. 19 et s. : 22 % des femmes ayant eu des relations avec un homme indique avoir subi des violences physiques ou sexuelles. Le taux est de 26 % en France, donc au-dessus de cette moyenne européenne. L’Espagne, l’Autriche, la Croatie, la Pologne et la Slovénie présentent le taux le plus bas, soit13%, alors que le taux le plus élevé de 32 % est relevé au Danemark et en Lettonie.
[4] V. V. Avena-Robardet, Violences conjugales en période de confinement, AJ fam., juin 2020, n° 6, p. 333. On évoque une hausse de 30 % de ces violences.
[5] On recense une loi tous les 4 ans environ depuis 2006. V. loi n° 2006-399, du 4 avril 2006, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (N° Lexbase : L9766HH8) ; loi n° 2010-769, du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (N° Lexbase : L7042IMR) ; loi n° 2014-873, du 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L9079I3N) ; loi n° 2018-703, du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (N° Lexbase : L6141LLZ).
[6] V. Ph. Conte, Féminicide : le poids des mots – et des chiffres, Dr. pén., janvier 2020, rep. n° 1 ; F.-L. Coste, « Féminicide » ou le code pénal et la Tour de Babel, AJ pénal, 2020, p. 289.
[7] Circ. CRIM, 2019-11, du 9 mai 2019, relative à l’amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes.
[8] Livre blanc de la Délégation aux droits des femmes sur la lutte contre les violences conjugales [en ligne].
[9] V. P. Januel, Violences conjugales : les députés dans l’impasse de la loi, Dalloz actualité, 17 janvier 2020 [en ligne].
[10] Loi n° 2019-1480 visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2114LUT). Pour une analyse du texte, v. A. Darsonville, Loi du 28 décembre 2019 : une approche pluri-disciplinaire dans la lutte contre les violences et au sein de la famille, AJ pénal, janvier 2020. p. 60 et Ph. Bonfils, Le renforcement de la lutte contre les violences au sein de la famille – commentaire de la loi du 28 décembre 2019, Dr. famille, 2020, étude 10. V. également H. Matsopoulou, Femmes. – Le bracelet anti-rapprochement au service de la lutte contre les violences faites aux femmes, JCP G, 2020, doctr. 279.
[11] Décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2138LXH).
[12] Faisant état des difficultés, v. not. J.-M. Garry et A. Boyard, Décret du 27 mai 2020 visant à agir contre les violences au sein de la famille : un recul stupéfiant des droits des victimes, Dalloz actualités, 5 juin 2020 et M. Ouchy-Doutot, L’installation du Comité national de pilotage de l’ordonnance de protection : une meilleure vigilance pour une protection plus efficace ?, Procédures, août 2020, n° 8-9, alerte 10.
[13] Décret n° 2020-841, du 3 juillet 2020, modifiant les articles 1136-3 du Code de procédure civile et R. 93 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : Z791919W).
[14] Mme Schiappa a confirmé que les premiers bracelets devraient être opérationnels à partir du mois de septembre sur France Inter, le 30 août 2020.
[15] Proposition de loi n° 2478, déposée le 3 décembre 2019 à la présidence de l’Assemblée nationale [en ligne].
[16] La loi apporte également des modifications au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de protéger les étrangers victimes de violences conjugales ou familiales.
[21] On doit y ajouter l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, est applicable en vertu de l’article 132-80 du Code pénal (N° Lexbase : L6235LLI).
[22] C. pén., art. 222-16 (N° Lexbase : L8542LXN) : « Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
[23] C. pén., art. 226-4-1 (N° Lexbase : L8548LXU) : « Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
[24] C. pén., 226-15 (N° Lexbase : L8550LXX) : « Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende ».
[25] V. V. Wester-Ouisse, De l’incrimination du suicide d’un conjoint dit suicide forcé, JCP G, 2019, p. 1351.
[26] Cette version du harcèlement est issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
[27] Étude publiée en 2007 par Psytel, dans le cadre du programme Daphné, financé par la Commission européenne [en ligne].
[28] Les travaux préparatoires évoquent déjà la difficulté, v. également V. Wester-Ouisse, op. cit.